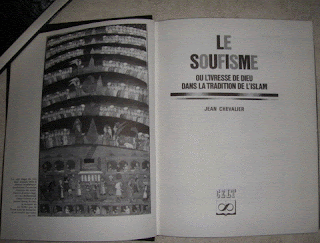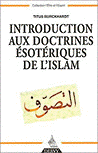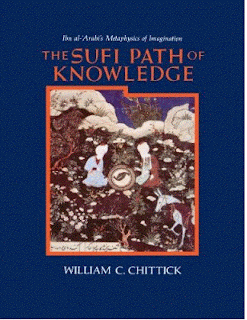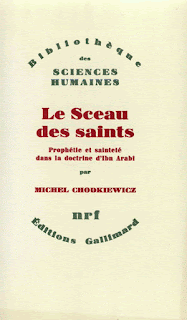مدخل للتصوف
مراجع هامة
Introduction au soufisme
Références majeures

Lings
: Qu'est-ce que le soufisme? Points Sagesse Paris 1977
Présentation de l'éditeur
Dernière Révélation en date, l'Islam affirme être un retour à la religion primordiale. Il constitue par ailleurs un pont entre l'Orient et l'Occident. On comprend la portée du soufisme - la forme qu'a prise la mystique en Islam - qui se définit comme une "saveur", et dont le but est la connaissance directe des vérités divines.
Ce livre, inédit en français, présente son histoire millénaire et son actualité, son originalité et son universalité, son but et sa méthode, dans leur ampleur et dans leur pureté.
Jean Chevalier : Le soufisme ou l'ivresse de Dieu dans la tradition de l'islam - Éd. Cultures, arts, loisirs. Collection : Bibliothèque de l'irrationnel et des grands mystères. Retz/Celt, Paris, 1974.
Table des matières Pages
INTRODUCTION 13
JARDINS MYSTIQUES SUR TERRES DE SANG 25
Les germes mystiques du Qoràn 39
L'étouffement juridicothéologique 48
La contagion spirituelle du milieu 55
Le rôle incitateur des philosophes psychagogues 68
FIGURES DE PROUE DE LEXPANSION MYSTIQUE 77
L'invasion mystique chez les philosophes 107
Sohrawardî ou larchange empourpré 126
Ibn Arabi le très grand maître 137
Jétais cru ou la jeunesse du poète 162
Shams de Tabriz 168
Le fondateur de Tordre des Derviches tourneurs 175
L'expérience de la parole 185
Guides et confréries 195
Les degrés de lascension mystique 207
Prière musique et danse 219
Amour et mystique 237
Vocabulaire des termes arabes 251
Article d'Éric Geoffroy
L’islamité du soufisme et son apport à la spiritualité universelle
* La conduite des soufis est la plus parfaite, leur cheminement le meilleur, et leur caractère le plus pur.
Ghazâlî, célèbre savant, surnommé « la preuve de l’islam » (m. 1111) [1].
* Le soufisme est une des sciences de la Sharî‘a.
Ibn Khaldûn, savant et historien bien connu (m. 1406) [2].
* La Loi (Sharî‘a) et la Réalité spirituelle (Haqîqa) sont indissociables.
Z. al-Ansârî, grand cadi égyptien (m. 1520) [3].
Ces quelques témoignages émanant de personnalités de l’islam exotérique situent d’emblée la spiritualité islamique dans une perspective centrale par rapport à la religion qui la supporte. Le soufisme, loin d’être un phénomène marginal, excentrique au sein de l’islam, en représente au contraire la quintessence, le « coeur » (lubb), comme l’ont affirmé tant de maîtres. Il ne s’agit nullement d’une pétition de principe ou d’un voeu pieux, mais d’une réalité historique qu’aucun chercheur sérieux ne peut nier. Répétons-le à ceux qui, dans leurs diatribes, osent encore utiliser le soufisme comme levier contre l’islam : il n’y a pas d’une part un islam exotérique qui se réduirait à un formalisme juridique, et d’autre part une mystique d’essence hétérodoxe, espace de "liberté", qui aurait vu le jour en réaction à ce carcan. L’islam, comme toute religion sémitique, part des réalités les plus concrètes, les plus extérieures, pour les intérioriser et les spiritualiser. Les cinq piliers de l’islam, par exemple, sont habités par le soufisme, comme l’esprit habite le corps. Car qu’est-ce que le soufisme sinon le fait de « goûter » la dimension ésotérique, spirituelle de l’islam ? C’est cette perception qui donne tout son sens aux versets du Coran, aux piliers de l’islam et à ses différents rites. L’islam trouve précisément sa plénitude dans cet équilibre entre la matière et l’esprit, entre le rite et son efficience symbolique et initiatique.
Le soufisme et le Coran
Certains anciens orientalistes, mûs par des considérations d’ordre idéologique plus que scientifique, cherchèrent des origines non islamiques au soufisme : une spiritualité aussi puissante, aussi universaliste ne pouvait émaner de la « religion de Mahomet » ! Ils rivalisèrent alors pour trouver, qui une source chrétienne, qui une source hindoue, qui une source hellénistique... à la mystique musulmane. Ces allégations ont été nettement et définitivement réfutées par L. Massignon (m. 1962) - célèbre islamologue, et grand chrétien aussi - lequel a prouvé le caractère foncièrement coranique du soufisme. « C’est du Coran, constamment récité, médité, pratiqué, que procède le mysticisme islamique, dans son origine et son développement » déclarait Massignon [4]. Dans sa célèbre thèse, La Passion de Hallâj, publiée la première fois en 1914, il reconnaissait qu’ « il y a dans le Coran les germes réels d’une mystique, germes susceptibles d’un développement autonome, sans fécondation étrangère » [5]. De façon révélatrice, un polémiste aussi malveillant que M. Ibn Warraq se fonde sur des orientalistes antérieurs à Massignon pour arguer de la non-islamité du soufisme [6]. Parmi eux figure Nicholson, à propos duquel l’islamologue allemande contemporaine A. Schimmel, bien connue elle aussi, déclare : « Nicholson n’a pas compris que le mouvement ascétique du début [de l’islam] pouvait sans difficulté être expliqué à partir de ses racines islamiques et que, par conséquent, la forme originale du soufisme était un produit naturel de l’islam lui-même » [7].
Depuis, les chercheurs ont exploré beaucoup de textes inédits de la littérature soufie, et approfondi leur connaissance de l’oeuvre des grands maîtres : leur travaux confirment les intuitions de Massignon, et établissent, d’une manière ou d’une autre, l’axialité islamique du soufisme (ce qui, au demeurant, paraît logique). M. Chodkiewicz, par exemple, spécialiste incontesté d’Ibn ‘Arabî (m. 1240), a montré que l’exégèse que fait ce maître du Coran témoigne de « la plus scrupuleuse attention à la lettre ». « En tous ses écrits, poursuit-il, le Coran est visiblement ou invisiblement présent à la fois dans la texture de l’enseignement qu’ils enferment et dans la structure qui en ordonne l’exposé » [8]. Dans le cadre qui nous est imparti, nous ne pouvons citer un certain nombre de versets ayant une portée directement spirituelle, voire initiatique, et que tout musulman "soufi" médite (rappelons au passage qu’une proportion assez faible de versets a une nature juridique ou normative). C’est presque une banalité de dire que les traités doctrinaux des maîtres soufis se nourrissent du Coran et du Hadîth (paroles du Prophète). Il faut mentionner tout spécialement les hadîth qudsî, paroles divines rapportées par le Prophète, dans lesquelles Dieu s’adresse, à la première personne, aux croyants ou aux hommes en général : Dieu nous y fait pénétrer dans Son intimité et Sa proximité.
Ce qui précède ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu d’emprunt de la part du soufisme à l’une ou l’autre spiritualité (christianisme, hindouïsme, bouddhisme...), mais là n’est pas l’essentiel. Par ailleurs, le soufisme a lui aussi influencé d’autres mystiques. Ainsi, il est maintenant avéré que Saint Jean de la Croix a assimilé des éléments doctrinaux provenant de l’école shâdhilie, implantée notamment au Maghreb. Nous pourrions multiplier les exemples.
Le soufisme et la Loi (Sharî‘a)
Parmi les autres poncifs ressassés par les anciens fossoyeurs de l’islam - et qui ne sont plus du tout crédibles aujourd’hui - figure le mépris qu’auraient affiché les soufis à l’égard de la Sharî‘a et des prescriptions islamiques en général. Voyons donc ce que pensaient les quatre fondateurs de rites juridiques, censés être à l’origine du soit-disant légalisme ritualiste de l’islam. On constate d’abord qu’ils sont unanimement considérés comme des saints (awliyâ’), et non comme de simples juristes. Le premier dans l’ordre chronologique, Abû Hanîfa, a même exercé une sorte de maîtrise spirituelle puisqu’il figure dans une chaîne initiatique majeure du soufisme [9]. Du deuxième, l’imam Mâlik, nous possédons un aphorisme précieux : « Celui qui s’adonne au soufisme sans connaître le droit musulman tombe dans l’hérésie ; celui qui étudie le droit en négligeant le soufisme finit par corrompre son âme ; seul celui qui pratique les deux sciences parvient à la réalisation spirituelle ». Du troisième, l’imam al-Shâfi‘î, nous avons cet aveu : « J’aime trois choses en ce monde : l’absence de maniérisme, fréquenter les humains dans une atmosphère paisible, et suivre la voie des soufis » [10]. Le quatrième, Ahmad Ibn Hanbal, était d’abord hostile aux soufis, puis, après avoir côtoyé l’un d’entre eux, il fit à son fils cette recommandation : « Cherche la compagnie des soufis, car ils nous dépassent quant à la science, le contrôle de soi et l’énergie spirituelle » [11].
Certes, les premiers mystiques ont parfois perdu pied au cours de leurs expériences pionnières, mais ils ont pu les mener à bien parce qu’ils restaient dans le cadre protecteur des sources scripturaires et de la Loi. Junayd de Bagdad (m. 911), surnommé « le seigneur de l’Ordre des soufis » et qui reste la référence majeure des spirituels musulmans insistait sur ce point : « Ne suivez jamais quelqu’un qui ne maîtrise ni le Coran ni la Tradition du Prophète, car notre science [le soufisme] est totalement liée à l’un et à l’autre » [12]. Comment M. Ibn Warraq peut-il affirmer qu’Abû Yazîd Bistâmî (qu’il fait d’ailleurs mourir sept siècles plus tard qu’il ne le faudrait !) accordait peu de valeur à l’observance de la Sharî‘a, alors que le saint a déclaré expressément son attachement à celle-ci, saint qui jeûnait tout au long de l’année, lisait le Coran dans sa totalité chaque jour et a accompli quarante-cinq fois le Pèlerinage [13] ? Quant au célèbre Hallâj (m. 922), dont M. Ibn Warraq fait un martyr du « légalisme froid » de l’islam [14], on sait qu’il recherchait la mort et qu’il a dans ce but provoqué les autorités religieuses et surtout politiques. Son propre maître, Junayd, l’avait d’ailleurs désavoué auparavant, et Ibn ‘Arabî voyait dans ce désir de la mort physique (le soufi vise la mort initiatique) une déficience spirituelle [15]. Ibn Warraq met également en cause l’orthodoxie du cheikh Abû Sa‘îd (m. 1049), lui qui passait ses nuits à lire le Coran et ses journées à balayer les mosquées, lui à propos duquel un grand savant exotérique confessa : « Personne ne possède ce que le Shaykh tient de la Loi religieuse et de la Voie mystique » [16].
Il ne faut pas confondre la périphérie avec le centre, l’exception avec la règle. Il y a toujours eu des derviches hétérodoxes, que les soufis ont appelé « les intrus », et qu’ils ont été les premiers à stigmatiser. Le soufi ne transgresse pas la Sharî‘a ; il en épouse la lettre pour mieux la transmuer en esprit. La lettre est aussi indispensable à l’esprit que l’esprit l’est à la lettre : en vérité, il s’agit des deux faces d’une même réalité. Un spiritualiste - formule moins restrictive que le terme "soufi" - respecte en définitive davantage la Loi sacrée qu’un autre musulman, car il en perçoit mieux la profondeur de sens. Pour lui, la Loi ne se résume pas à un ensemble d’injonctions et à un cadre de protection ; elle est, à travers tout cela et au-delà, source d’illumination. Il s’agit là d’une conception difficile à appréhender pour les Occidentaux.
Nous avons un témoignage précieux, car impartial, en la personne d’Ibn Khaldûn, souvent considéré comme le fondateur de la philosophie de l’histoire, et de la sociologie. Or celui-ci réfute l’accusation selon laquelle les mystiques auraient développé « une seconde Loi » : « l’océan sans fin de leur goût spirituel, déclare t-il, s’insère dans les cinq piliers, de la même façon que le particulier s’inscrit dans le général » [17].
Objectivement, l’idéal de nombre de musulmans, et de savants/oulémas parmi eux, a été de réaliser l’osmose entre l’exotérique et l’ésotérique, entre la Loi et la Voie, entre l’esprit et la lettre. Nous trouvons ainsi de façon récurrente, dans les sources, le profil du savant-soufi. Ce qui est remarquable, c’est que ce sont les plus grands savants de leur temps qui étaient affiliés au soufisme. Quoi de plus normal ? Les soufis se définissent comme l’élite spirituelle (al-khâssa), qui correspondait le plus souvent, dans les sociétés traditionnelles, à l’élite intellectuelle. A l’université al-Azhar du Caire, on enseigne, depuis au moins le XIIIe siècle, le soufisme au même titre que les autres sciences islamiques et, lorsqu’on lit les sources médiévales, on parvient parfois difficilement à distinguer le soufi du savant ou du juriste. L’école shâdhilie compte nombre de personnages ayant ce profil, depuis Ibn ‘Atâ’ Allâh, qui enseignait à al-Azhar « les deux sciences, exotérique et ésotérique » [18] jusqu’au recteur de cette université dans les années 1960 : le cheikh ‘Abd al-Halîm Mahmûd. Il en va de même à l’heure actuelle où, pour nous limiter à un seul exemple, le grand mufti - quoi de plus officiel en islam ? - de Syrie est aussi un cheikh naqchbandi notoire. Du XIIIe au XIXe siècle, c’est toute la société musulmane qui était fortement imprégnée de mystique, du simple artisan au gouvernant. Les sultans ottomans n’étaient-ils pas été affiliés à une ou plusieurs confréries ?
Pour mieux infirmer la représentation d’un légalisme étroit que d’aucuns ont de l’islam, prenons l’exemple de Suyûtî (m. 1511), savant égyptien sollicité de son vivant pour ses fatwâ, de l’Inde musulmane jusqu’au Sahel. Il est encore très lu aujourd’hui car il a laissé environ mille ouvrages ! Or les fatwâ de Suyûtî concernent aussi bien le droit, bien sûr (d’où la traduction de fatwâ par "avis juridique"), que la langue ou ... le soufisme. Il y avance notamment, en partant de cas concrets, que les saints ont le don d’ubiquité et qu’ils ont pouvoir sur le monde des formes, ou encore que le Prophète avait parlé explicitement de l’existence d’une hiérarchie ésotérique des saints. Lui-même étant rattaché à un maître soufi, Suyûtî va user de son prestige scientifique pour mieux asseoir la mystique au sein de la culture islamique. Il affirme ainsi que le "dévoilement intuitif" des soufis est infaillible, et qu’il a autant de valeur juridique que n’importe quelle déduction rationnelle : une telle audace doctrinale, il faut en convenir, venant d’une autorité à priori "exotérique", ne va de soi dans aucune religion instituée.
Jusqu’à ce qu’apparaisse l’idéologie wahhabite (XVIIIe s.), nul savant ne rejetait en bloc la mystique. Les censeurs n’en critiquaient que des aspects précis, ce qui ne les empêchait pas d’être eux-mêmes affiliés au soufisme ! Le meilleur exemple, sur ce point, reste Ibn Taymiyya (m. 1328). Les Wahhabites, notamment, ont tronqué sa véritable personnalité en présentant ce "docteur de la Loi" comme un adversaire acharné du soufisme, alors que lui-même revendique son rattachement à un ordre initiatique et valide, dans de belles pages, l’expérience spirituelle des maîtres anciens. Certes, on ne saurait nier le clivage ayant existé et existant entre certains milieux exotéristes et les soufis, mais d’une part ce clivage se repère dans les autres religions, d’autre part il ne remet pas en cause la nature foncièrement spirituelle du message islamique.
Comment, au demeurant, les soufis évolueraient-ils en marge de l’islam alors que leur référence première et dernière est le prophète Muhammad, venu apporter la Loi et la Voie de l’islam ? Qu’est-ce que le soufisme sinon suivre le modèle prophétique (Sunna), c’est-à-dire imiter le Prophète extérieurement (dans ses paroles et ses actes) mais aussi intérieurement (dans ses états spirituels) ? L’amour et la dévotion que lui portent les musulmans, c’est bien connu, ont été en grande partie suscités et stimulés par les soufis. La célébration du Mawlid (fête anniversaire de la naissance du Prophète) en est un exemple probant. Les différents maîtres et saints qui sont apparus au cours des siècles ne sont que des aspects du Prophète, et la plupart étaient en contact subtil avec lui. Certains n’ont même eu que lui pour maître, par le biais de la vision (ru’yâ, laquelle a toujours été validée en islam). Les lignages initiatiques des ordres soufis prennent leur source dans le Prophète, et tout soufi authentique, quelle que soit son affiliation à telle ou telle voie particulière, a conscience de suivre la « Voie muhammadienne ».
C’est précisément parce qu’ils sont enracinés dans la tradition de l’islam que les soufis ont perçu « l’unité transcendante des religions ». L’islam, on le sait, reconnaît les révélations antérieures, qu’il synthétise et intègre. Il se considère comme le dernier fruit, pour cette humanité, de la Religion primordiale (al-dîn al-qayyim). L’ouverture des soufis aux autres religions découle donc de l’universalisme même de l’islam et du texte coranique : « Si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté, mais Il a voulu vous éprouver par le don qu’Il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les oeuvres de bien. Votre retour à tous se fera vers Dieu ; Il vous éclairera, alors, au sujet de vos différends » (Coran 5 : 48). L’islam, ultime religion révélée, rejoint ici l’hindouisme, religion primordiale, en ce qu’il envisage la Révélation dans sa manifestation universelle tout au long des cycles de l’histoire humaine. Nombre de musulmans, il faut le reconnaître, par le poids des coutumes et de la routine, ne sont pas à la hauteur de ce message.
Dans cette perspective, les soufis peuvent être définis tout simplement comme les musulmans réels, entiers, qui perçoivent et vivent l’essence de leur religion. C’est pourquoi ils se sont battus contre la sclérose touchant, par l’usure du temps, la religion à l’égal de toute autre institution. Le soufisme est une discipline d’éveil, qui pourfend les dogmatismes étroits, quels qu’ils soient. C’est en ce sens que certains soufis déclaraient n’être « ni musulmans, ni juifs ni chrétiens » : il s’agissait d’abord pour eux d’ébranler le conformisme inhérent à tout milieu religieux ; ils marquaient par ailleurs leur attachement à la Religion primordiale. Voici ce que disait Rûmî, poète de l’Amour mystique universel, qui était vénéré par les chrétiens autant que par les musulmans d’Anatolie : « La différence entre les créatures résulte de leur forme extérieure ; lorsqu’on pénètre dans la signification intérieure, il y a la paix. Ô moelle de l’existence ! C’est à cause de ce point de vue qu’ont divergé musulmans, zoroastriens et juifs ». Parce qu’il vise cette signification intérieure, le soufisme a pour vocation de plonger dans l’unité mystérieuse qui sous-tend la diversité des formes religieuses. Pour autant, on l’aura compris, les soufis étaient profondément musulmans, c’est-à-dire « soumis activement à Dieu » (sens du mot arabe muslim) : c’est en ce sens que le terme, dans le Coran, est appliqué aux prophètes et sages anciens.
Toute personne se réclamant de l’islam doit authentifier le message des prophètes qui ont précédé Muhammad (au nombre de 124.000, d’après ses termes). Un des arguments scripturaires est cette parole du Prophète : « Nous autres, les prophètes, sommes des frères issus d’une même famille. Notre religion est unique ». Certains - qu’on les appelle "soufis" ou non - parviennent à vivifier, à porter en eux la modalité spirituelle propre à chacun des grands prophètes. C’est donc dans le cadre de l’islam que les soufis ont accès à ce formidable patrimoine, en réalisant intérieurement l’héritage de l’un ou l’autre de ces prophètes. Ainsi, il est dit de tel saint musulman qu’il est "abrahamique", "mosaïque" ou "christique". Encore faut-il souligner que cet héritage ne peut être effectif, selon le soufisme, que grâce à la "fonction prophétique totalisante" de Muhammad. « Pour un chrétien, remarque S. H. Nasr, toute la grâce de Dieu est centrée dans la personnalité du Christ et aucune autre voie de grâce n’est ouverte à l’homme. Pour le musulman, dans le firmament de l’Islam, où le Prophète est comme la pleine lune, les autres grands prophètes et grands saints sont comme des étoiles qui brillent dans le même firmament, mais ils le font par vertu de la grâce de Muhammad » [19].
Ainsi, nombre de chrétiens ont été frappés par l’aspect christique du cheikh algérien Ahmad al-‘Alawî [20] et, encore maintenant, l’ordre soufi qu’il a initié a une grande influence sur les milieux chrétiens d’Occident. Pour les soufis, le dialogue interreligieux n’est donc pas une trouvaille récente ; il découle directement du principe de « l’unité transcendante des religions » inclus dans l’islam. Nul syncrétisme, évidemment, dans cette démarche, puisque la pluralité des religions fait partie du plan divin : « À chacun de vous, Nous avons donné une voie et une règle » (Coran 5 : 48).
De nos jours, on assiste à un renouveau du soufisme : en pays musulman d’abord, parce que les différentes idéologies, panarabe, islamiste et autres, sont mortes, et que seul reste l’Esprit ; en Occident également parce que le soufisme répond à un besoin spirituel, voire initiatique, réel. Les responsables musulmans qui vivent ici (présidents de mosquées, d’associations, imams...) sont eux-mêmes de plus en plus ouverts à cette dimension de l’islam. L’actualité du soufisme en Occident se résume à cette remarque : aux États-Unis, Rûmî, évoqué plus haut, maître fondateur des Mevlevis ("Derviches tourneurs") est le poète le plus lu. Actuellement, on décèle ici et là une contrefaçon de la spiritualité authentique, comme si le soufisme venait s’ajouter au catalogue des sagesses orientales en vogue. Des personnalités scientifiques, artistiques, voire politiques adhéreraient au soufisme ... Il faut rappeler à ceux qui veulent suivre cette voie initiatique qu’elle comporte des dangers, et qu’elle nécessite, outre un maître, le cadre protecteur de la Loi.
Le soufisme, qui traque les illusions et les leurres de l’ego, aura certainement un effet salvateur pour mettre à nu les idolâtries matérialistes qui ont succédé aux idolâtries religieuses d’antan. Là encore, il ne fait qu’intérioriser la doctrine de l’islam. Le péché majeur, en islam, consiste à « associer une autre divinité à Dieu » (shirk). Transposé sur le plan ésotérique, cela signifie, disent les soufis, que nous associons toujours à Dieu notre petit "moi" dans lequel nous nous enfermons, que nous le prenons comme « passion », ainsi que l’indique le Coran (25 : 43). Que dire alors de nos idolâtries actuelles, technologiques, idéologiques et autres ?
En-deçà de la quête proprement initiatique qu’il propose, le soufisme permet à certains musulmans de découvrir l’essence spirituelle de l’islam et de régénérer leur pratique cultuelle. Il témoigne en effet que l’ensemble des dogmes, prescriptions et rites de l’islam est animé par l’Esprit. Nous avons déjà souligné l’élan pionnier donné par le soufisme dans le sens du dialogue interreligieux. Le soufisme a aussi pour mission de faire connaître à un public plus large « l’autre visage » de l’islam [21]. Il a enfin, croyons-nous, la capacité de faire évoluer l’islam vers une modernité empreinte de spiritualité.
Il y a même les « saints de Satan », et nous touchons là à la contre-initiation. Mais, comme le disait un maître, « ce n’est pas Satan qui se joue des soufis, ce sont eux qui se jouent de lui ».
Notes
[1] Cf. son Munqidh min al-dalâl, Beyrouth, 1969, p. 39 du texte arabe.
[2] al-Muqaddima, traduite par V. Monteil sous le titre Discours sur l’Histoire universelle, Beyrouth, 1968, III, p.1004.
[3] Cf. son commentaire de la Risâla qushayriyya, Beyrouth, 1957, p.43.
[4] Cf. son Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, 1ère éd. en 1922, 2e en 1954, 3e en 1999 (aux éd. du Cerf), p.104.
[5] Passion, Paris, 1975 (nouvelle éd.), III, 21.
[6] Dans son livre Pourquoi je ne suis pas musulman, Paris, 1999, p.332-334.
[7] A. Schimmel, Le soufisme, ou les dimensions mystiques de l’islam, Paris, 1996, p.25.
[8] M. Chodkiewicz, Un océan sans rivage : Ibn ‘Arabî, le Livre et la Loi, Paris, 1992, voir la 4e de couverture.
[9] Cf. la Hâshiya d’Ibn ‘Âbidîn, Boulaq, 1323 h., I, 43.
[10] al-‘Ajlûnî, Kashf al-khafâ’, Le Caire, 1351 h., I, 341.
[11] A. al-Kurdî, Tanwîr al-qulûb, Le Caire, 1358 h., p.405.
[12] Cf. al-Qushayrî, Risâla, p.431.
[13] Cf. Ibn Warraq, op. cit., p.334 ; A. al-Badawî, Shatahât al-sûfiyya, Koweit, 1978, p.133, 218, 226.
[14] Ibn Warraq, op. cit., p.334.
[15] Junayd, Enseignement spirituel, traduit de l’arabe par R. Deladrière, Paris, 1983, p.215 ; M. Chodkiewicz, op. cit., p.115.
[16] M. Ebn E. Monawwar, Les étapes mystiques du shaykh Abu Saïd, Paris, 1974, p.47, 276.
[17] Cf. son Shifâ’ al-sâ’il, Tunis, 1991, p.237.
[18] Cf. Ibn ‘Atâ’ Allâh, La sagesse des maîtres soufis, ouvrage traduit par nos soins, Paris, 1998.
[19] Seyyed Hossein Nasr, Essais sur le soufisme, Paris, 1980, p.184.
[20] Cf. M. Lings, Un saint soufi du vingtième siècle, le Cheikh Ahmad al-‘Alawî, Paris (Seuil), rééd.
[21] Pour reprendre le titre d’un ouvrage d’Eva de Vitray-Meyerovitch, Paris, 1995.