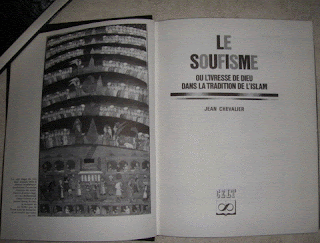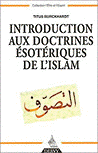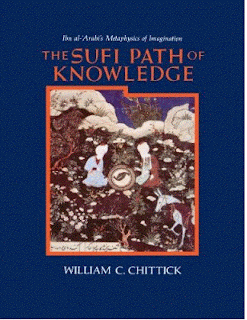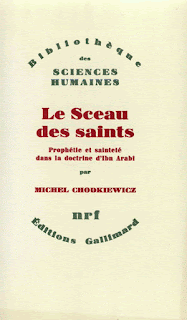مدخل للتصوف
مراجع هامة
Introduction au soufisme
Références majeures
A. Popovic et G. Veinstein (Direction) :
Les voies d'Allah.
Les ordres mystiques dans le monde musulman
des origines à aujourd'hui.
Paris, Fayard, 1996.
Présentation de : ALEXANDRE POPOVIC
Extrait du : Journal of the History of Sufism, (eds. Th. Zarcone, E. Ism, A. Buehler) Istanbul, Simurg P., 2000,1-2, XXIII-XXVIII.
Si le présent volume est dédié à Alexandre Popovic, c’est que les contributeurs ont presque tous été déjà réunis grâce à lui, soit dans le cadre d’un colloque, soit à l’occasion d’une publication sur les confréries mystiques musulmanes. De fait, il a été, dans ces vingt dernières années, l’un des principaux promoteurs et animateurs de la recherche mondiale dans ce domaine.
Mais là ne s’arrête pas sa contribution à la science. Son travail de chercheur, entamé dans les années 1960 et ponctué de très nombreuses publications, pourrait être qualifié à la fois de marquant, d’atypique et de pionnier.
De son profil d’émigré d’un pays de l’Est (la Yougoslavie), qui aurait pu être pour lui un handicap, voire le priver de toute carrière dans l’orientalisme, il a su faire un atout, en osant quitter les routes balisées de l’étude de l’islam classique et du monde musulman central, pour se lancer, au risque d’être marginal, sur le sentier alors peu emprunté des recherches sur l’islam et les musulmans des Balkans.
DE BELGRADE À PARIS :
Né à Belgrade, en 1931, dans une famille originaire de la Serbie occidentale, il apprit le français alors qu’il fréquentait l’école Saint Joseph des frères jésuites, où son père était enseignant. À la sortie du lycée, il choisit de faire des études de philologie orientale (arabe, turc, persan) auprès du célèbre professeur de l’époque, Fehim Bajraktarevic. Il pensait avant tout que cette formation (tout comme le sport dans lequel il excellait) lui permettrait un jour de sortir du carcan imposé par le nouveau régime communiste.
Quelques temps après avoir obtenu son diplôme et grâce à un concours de circonstances, il put en effet partir pour Paris, où il arriva au début du mois de novembre 1954. Il s’inscrivit alors à l’École des langues orientales pour faire un diplôme d’arabe littéral, tout en survivant grâce à de multiples « petits boulots ».
Il fit ensuite, avec Charles Pellat, une thèse sur la révolte des Zandj en Irak au III/IXe siècle (soutenue en 1965, et publiée en XIV Alexandre POPOVIC 19761), un sujet qu’il avait choisi afin de montrer le caractère fantaisiste des interprétations marxistes de l’événement.
En 1967, il devint « collaborateur technique » de l’un des plus grands orientalistes français, Maxime Rodinson, et occupa ce poste durant plus de dix ans.
DE L’ISLAM CLASSIQUE À L’ISLAM PÉRIPHÉRIQUE :
C’est au cours de cette période qu’il décida pourtant de se diriger vers un domaine resté jusque là presque vierge : celui de l’islam du pays dont il est originaire, la Yougoslavie, et des autres pays balkaniques, qui plus est, à l’époque moderne.
Dès le début des années 1970, il posa les bases de ses futurs travaux dans une série d’articles2. Il était aussi l’auteur de nombreux comptes-rendus qui, d’un côté, lui permettaient « d’apprendre le métier », comme il aime à le dire lui-même, et de l’autre, donnaient aux chercheurs occidentaux la possibilité d’accéder à la littérature spécialisée en langue serbo-croate.
À partir de 1973, un séminaire à l’École pratique des Hautes Etudes, VIe section (la future École des Hautes Etudes en Sciences Sociales), intitulé « Histoire moderne et contemporaine des musulmans balkaniques », lui permit d’analyser et de présenter la volumineuse documentation qu’il rassemblait peu à peu. Ce travail aboutit à la rédaction d’une thèse d’État (dirigée par Robert Mantran), publiée sous le titre : L’Islam balkanique. Les musulmans du sud-est européen dans la période post-ottomane (Berlin-Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1986, 493 p.). Il s’agit d’une somme qui est un manuel incontournable pour qui s’engage désormais dans l’étude de l’histoire des musulmans des Balkans.
Devenu entre-temps chercheur au C.N.R.S., il s’intéressa également plus particulièrement à certains thèmes, tels : la littérature des musulmans des Balkans (il a, depuis 1975, un séminaire sur ce thème à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, IVe section) ; les articulations entre islam et politique ; la presse des musulmans ; et surtout la « dervicherie », c’est-à-dire l’étude des confréries mystiques musulmanes (voie dans laquelle l’encouragea Alexandre Bennigsen). Outre de nombreux articles dont il serait trop long de faire la liste ici et dont une partie a été récemment rassemblée dans trois volumes parus aux Éditions Isis d’Istanbul3, il est l’auteur, sur ces sujets, de plusieurs ouvrages, comme : Les Musulmans yougoslaves (1945-1989). Médiateurs et métaphores, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1990 ; Presse turque et Presse de Turquie. Actes des colloques d’Istanbul, ouvrage édité par N. Clayer, A. Popovic et Th. Zarcone, Istanbul, Paris, Éditions Isis, 1992, 366 p. ; et d’autres sur lesquels nous allons revenir.
Cependant, ne parler que de sa production personnelle ne saurait rendre la dimension de son activité. Car, depuis le début des années 1980, il est avec d’autres (parmi lesquels Marc Gaborieau, Alexandre Bennigsen, Denis Lombard) à l’origine de la formation en France d’une équipe de recherche (« La transmission du savoir dans le monde musulman périphérique »), mais aussi d’un réseau international, travaillant sur le monde musulman « périphérique » (c’est-à-dire les pays de la « seconde expansion de l’islam » à partir des pays arabes, de l’Iran et de la Turquie, régions beaucoup plus étudiées jusque là). Il a édité pendant 10 ans la « Lettre d’information » de cette équipe, a été l’un des organisateurs, des animateurs et/ou l’un des responsables de l’atmosphère conviviale et détendue de nombreux colloques.
Il a aussi été l’une des chevilles ouvrières de la publication des actes de plusieurs de ces réunions. La plupart d’entre elles touche à un thème qui lui est cher, et auquel le présent volume se rattache : l’étude des confréries mystiques musulmanes, et représente autant d’avancées dans notre connaissance des tarikat. Ainsi, une série s’est peu à peu forgée, de réunion en réunion, de volume en volume, depuis 1986 :
— Les Ordres mystiques dans l’Islam. Cheminements et situation actuelle (Travaux publiés sous la direction de A. Popovic et G. Veinstein), Paris Éditions de l’EHESS, 1986, 327 p.
— M. Gaborieau, A. Popovic et Th. Zarcone (éds), Naqshbandis. Cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman, Istanbul - Paris, Institut Français d’Études Anatoliennes - Editions Isis, 1990, 750 p.
— A. Popovic et G. Veinstein (éds.), Bektachiyya. Études sur l’ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, Istanbul, Les Éditions Isis, 1995, 476 p. (également dans Revue des Études islamiques, LX, 1992-1 [1997], Paris, Geuthner, 468 p.).
— Les voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, A. Popovic et G. Veinstein (sous la direction de), Paris, Fayard, 1996, 715 p. (traduction en catalan : Las sendas de Allah. Las cofradias musulmanas desde sus origines hasta la actualidad, Barcelona, Edicions Bellaterra, 1997, 831 p.).
— Melâmis-Bayrâmis. Études sur trois mouvements mystiques musulmans (réunies par Nathalie Clayer, Alexandre Popovic et Thierry Zarcone), Istanbul, Les Éditions Isis, 1998, 325 p.
Quant à ses propres publications sur les confréries mystiques dans les Balkans, elles ont été tout à fait novatrices4.
Enfin, s’il fallait lui rendre hommage encore sur un point, il faudrait souligner le fait que, toujours accessible, toujours disponible, toujours prêt à partager ses expériences et sa documentation, toujours naturel, toujours plein d’humour et chaleureux, il a su et il sait communiquer à de jeunes chercheurs l’enthousiasme de la recherche, la patiente et la précision nécessaires à ce type de travail, la nécessité de connaître le terrain, l’importance des données factuelles, et « last but not least » la prudence à avoir vis-à-vis du « politically correct » d’un côté et de l’idéologie ou de l’apologie de l’autre ...
Notes :
1 La Révolte des esclaves en Irak au IIIe/IXe siècle, Paris, Geuthner, 1976 [= Bibliothèque d’Etudes Islamiques, VI], 218 p. (édition en anglais : The Revolt of African Slaves in Iraq in the 3rd/9th century, Princeton, Markus Wiener Publishers, 1998, 207 p.).
2 Voir notamment « Problème d’approche de l’islam yougoslave », Correspondance d’Orient, n°11, Bruxelles, août-septembre 1971, p. 367-76 ; « La Littérature ottomane des musulmans yougoslaves. Essai de bibliographie raisonnée », Journal Asiatique, CCLIX/3-4, 1971, p. 309-
376 ; « Les Musulmans du Sud-Est européen dans la période post-ottomane problèmes d’approche », Journal Asiatique, CCLXIII/3-4 , 1975, p. 317-360.
3 Les Derviches balkaniques hier et aujourd’hui, Istanbul, Isis, 1994, 373 p. ; Les Musulmans des Balkans à l’époque post-ottomane : Histoire et politique, Istanbul, Isis, 1994, 375 p. ; et Cultures musulmanes balkaniques, Istanbul, Isis, 1994, 283 p.
4 On en trouvera la liste ci-dessous.
Nathalie CLAYER
Publications d’Alexandre Popovic sur les confréries :
— « Les Statuts de la communauté musulmane albanaise (Sunnites et Bektachis) de 1945 » (en collaboration avec Odile Daniel), Journal Asiatique, CCLXV/3-4, 1977, p. 273-306.
— « Un texte inédit de Hasan Kaleshi ‘L’ordre des Sa‘diya en Yougoslavie’ », in Quand le crible était dans la paille ..., Hommage à Pertev Naili Boratav, présenté par R. Dor et M. Nicolas, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1978, p. 335-348.
— « The contemporary Situation of the Muslim Mystic Orders in Yugoslavia », in Islamic Dilemmas : Reformers, Nationalists and Industrialization (The Southern Shore of the Mediterranean), E. Gellner (éd.), Berlin-New York-Amsterdam, Mouton, 1985, p. 240-254.
— « Les Ordres mystiques musulmans du Sud-Est européen dans la période post-ottomane », in Les Ordres mystiques dans l’Islam. Cheminements et situation actuelle (Travaux publiés sous la direction de A. Popovic et G. Veinstein), Paris, Éditions de l’EHESS, 1986, p. 63-99. (traduction en turc par Osman Türer : « Osmanli sonrasi dönemde Güney-Dogu Avrupa’daki müslüman tarîkatlar », Türk Kültürü Arashrmalari, XXV/1, Ankara, 1987 [1988], p. 85-126 ; paru aussi dans Ilim ve Sanat, 37, Istanbul, Kasim 1993, p. 62-72).
— «Typologie de la survie d’un ordre mystique musulman en Yougoslavie : le cas des Kâdiris de Kosovska Mitrovica », Quaderni di Studi Arabi, 5-6, Venezia, 1987-1988 (Atti del XIII Congresso de l’UEAI, set.-ott. 1986), p. 667-678 (traduction en serbo-croate par Tarik Haveric : « Tipologija odranja jednog mistikog islamskog reda u Jugoslaviji. Slucaj Kadirija u Kosovskoj Mitrovici », Islamska Misao, XIII/146, Sarajevo, februar 1991, p. 42-47).
— « Les Ordres mystiques musulmans dans les territoires yougoslaves au dix-huitième siècle », in : Mélanges Professeur Robert Mantran (Études réunies et présentées par Abdeljelil Temimi), Zaghouan-Tunisie, CEROMDI, 1988, p. 201-208.
— Ç Bilten ‘Hu’ et autres publications récentes des derviches yougoslaves », in Langues et Cultures populaires dans l’aire arabo-musulmane 2 (Journées d’Études Arabes - Paris, Février-Mars 1988), Paris, AFDA, 1988, p. 95-99.
— « Les Derviches balkaniques I : la rifâ‘iyya (première partie)», Zeitschrift fŸr Balkanologie, 25/2, Berlin, 1989, p. 167-198.
— « Quelques remarques sur les Naqshbandis dans le Sud-Est européen (période post-ottomane) », in M. Gaborieau, A. Popovic et Th. Zarcone (éds.), Naqshbandis. Cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman, Istanbul - Paris, Institut Franèais d’Études Anatoliennes - Éditions
Isis, 1990, p. 657-662.
— « Les Derviches balkaniques I : la rifâ‘iyya (Deuxième partie)», Zeitschrift fŸr Balkanologie, 26/2, Berlin, 1990, p. 142-183 (traduction des deux parties en serbo-croate : « Balkanski dervisi : I. Rifaije », Zbornik za Orijentalne Studije, 1, Belgrade, SANU, 1992, p. 155-224).
— « Les Ordres mystiques musulmans dans les Balkans à l’époque post-ottomane », Anatolia Moderna - Yeni Anadolu, II (Derviches et cimetières ottomans), Paris-Istanbul, Librairie d’Amérique et d’Orient / IFÉA, 1991, p ; 221-226.
— « Les Derviches balkaniques II : Les Sinanis », Turcica, XXI-XXIII [= Mélanges offerts à Irène Mélikoff par ses collègues, disciples et amis], 1991, p. 83-113.
— « Les Derviches balkaniques III : Les Shâdhilis », in : B.S. Amoretti et L. Rostagno (ed.), Yadnama in memoria di Alessandro Bausani, Roma, Bardi 1991, Vol. I, p. 389-407.
— « Sur les traces des derviches de Macédoine yougoslave » (en collaboration avec Nathalie Clayer), Anatolia Moderna - Yeni Anadolu, IV (Derviches des Balkans, disparitions et renaissances), Paris, A. Maisonneuve, 1992, p. 13-63.
— « Les Derviches et la mort. (Sur quelques croyances liées à la mort chez les derviches des Balkans) », La Mort dans le domaine turc, ƒtudes turques et ottomanes, Documents de travail, n¡ 3, Paris, URA D1425 (CNRS), juin 1993, p. 43-55.
— « Les Ordres mystiques musulmans et la cité. (L’implantation des tekke dans les Balkans) È (en collaboration avec Nathalie Clayer), in Luigi Serra (éd.), La città mediterranea. Eredita antica e apporto arabo-islamico sulle rive del Mediterraneo occidentale e in particolare nel Maghreb. Atti del Congresso Internazionale di Bari, 4-7 maggio 1988, Napoli, Istituto Universitario
Orientale, 1993, p. 299-310.
— Un Ordre de derviches en terre d’Europe (La Rifâ‘iyya), Lausanne, L’Âge d’Homme, 1993, 160 p.
— Les Derviches balkaniques hier et aujourd’hui, Istanbul, Isis, 1994, 373 p. [= Analecta Isisiana IX].
— « Les Mevlevihane dans le Sud-Est européen È, Osmanli Arastirmalari (The Journal of Ottoman Studies), XIV, Istanbul, 1994, p. 152-158.
— « À propos des statuts des Bektachis d’Albanie », in A. Popovic et G. Veinstein (éds.), Bektachiyya. Études sur l’ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, Istanbul, Les Éditions Isis, 1995, p. 309-339 (également dans Revue des Etudes islamiques, LX, 1992-1 [1997], p. 301-326).
— « Les Balkans post-ottomans », in A. Popovic et G. Veinstein (sous la direction de), Les Voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Paris, Fayard, 1996, p. 380-388.
— « La Rifâ‘iyya », in A. Popovic et G. Veinstein (sous la direction de), Les Voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Paris, Fayard, 1996, p. 492-496.
— « Heurs et malheurs d’un centre de derviches dans l’ex-Yougoslavie », in A. Popovic et G. Veinstein (sous la direction de), Les Voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Paris, Fayard, 1996, p. 589-595.
— « Morts de saints et tombeaux miraculeux chez les derviches des Balkans », in Gilles Veinstein (sous la direction de), Les Ottomans et la mort. Permanences et mutations, Leiden-New York-Köln, E.J. Brill, 1996, p. 97-115.
— « La Troisième Phase des Melamis dans les Balkans », in Melâmis-Bayrâmis. Études sur trois mouvements mystiques musulmans (réunies par Nathalie Clayer, Alexandre Popovic et Thierry Zarcone), Istanbul, Les Éditions Isis, 1998, p. 179-205.
— « Magie, Islam / Balkans », « Soufisme, Islam/Balkans », Dictionnaire critique de l’ésotérisme (publié sous la direction de Jean Servier), Paris, PUF, 1998, p. 776-777 et 1225-1226.
— « Tarîka (II/6. La péninsule balkanique )» (en collaboration avec Nathalie Clayer), Encyclopédie de l’Islam, Nouvelle édition, tome X (livraisons 167-168), 1998, p. 272-274.
— « Les Courants anti-confrériques dans le Sud-Est européen à l’époque post-ottomane (1918-1990). Les cas de la Yougoslavie et de l’Albanie » (en collaboration avec Nathalie Clayer), in Frederick de Jong and Bernd Radtke (eds.), Islamic Mysticism Contested. Thirteen Centuries of Controversies and Polemics, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1999, p. 639-664.
— « L’Image de l’autre chez les musulmans des Balkans à l’époque post-ottomane : regards croisés entre les représentants de l’orthodoxie musulmane et les représentants de la mystique musulmane » (Actes de la Conférence « Le Sud-Est européen, carrefour de civilisations », Paris, UNESCO, 9 et 10 février 1998), Bulletin de l’Association Internationale d’Études du Sud-Est européen, 28-29, Bucarest, 1999, p. 215-219.