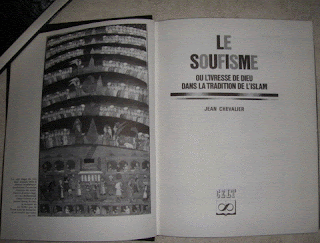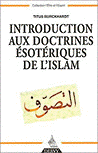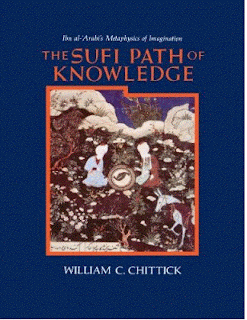مدخل للتصوف
مراجع هامة
Introduction au soufisme
Références majeures
رأينا في مقال سابق مدى إمكانية اعتبار التصوف الإسلامي مدخلا للنفسية العربية. وقبل مواصلة التعريف بالتصوف، نورد هنا كمدخل لدراسته أهم المراجع بالعربية واللاتينية. وقد استقيناها من مؤلف محمد بن الطيب : «إسلام المتصوفة» الصادر عن دار الطليعة، بيروت سنة 2007 في سلسلة «الإسلام واحدا ومتعددا» تحت إشراف الدكتور عبد المجيد الشرفي.
فمن الدراسات الجادة المفيدة بالعربية في معرفة التصوف، تلك التي لا تنزع كما هو الحال في الأغلب نزعتي المدح و القدح، نسوق المؤلفات التالية :
* أبو العلا عفيفي :
- التصوف : الثورة الروحية في الإسلام، القاهرة 1963
- «"الأعيان الثابتة" في مذهب ابن عربي - و"المعدومات" في مذهب المعتزلة» ضمن : الكتاب التذكاري محي الدين بن عربي، القاهرة، 1969 ص ص 209 - 220.
- «ابن عربي في دراساتي ضمن : الكتاب التذكاري محي الدين بن عربي في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده 1165-1240 مسيحي. القاهرة، 1969 ص ص 3 - 33.

* محمد مصطفى حلمي :
* سعاد الحكيم :
* نصر حامد أبو زيد :
* عبد اللطيف الشاذلي :
- التصوف والمجتمع، نماذج من القرن 10 هجرية، جامعة الحسن الثاني، 1989.
* عثمان يحي :
- تحقيق «الفتوحات المكية» لابن عربي.
* Othmane Yahya :
Histoire et classification de l'oeuvre d'Ibn Arabi, 2 vol. Thèse, Damas, 1964.
أما المراجع الأعجمية، فنلاحظ أولا أن أكثرها من النوع الوصفي الاستكشافي التي هدفها هو التعريف بالتصوف والاطلاع على أهم معالمه و أبرز أعلامه مع تقديم نماذج مترجمة من نصوصه. ومنها أيضا، مع ندرتها، دراسات علمية فيها سعة اطلاع وعمق في التفكير ونفاذ إلى دقائق المشكلات وتفطن إلى لطائف المعارف وغوامض المعاني. وتلحق بهذه الدراسات، من ناحية، مراجع معرفية ذات بال لجيل من الرواد في هذا الميدان، ومن ناحية أخرى، دراسات حديثة اعتنت بصفة خاصة بما يسمى بالتصوف الطرقي.
ومن النوع الأول، نسوق المراجع التالية :
* Jean Chevalier :
* Roger Deladrière :
- Junayd : Enseignement spirituel, traités, lettres, oraisons et sentences. Sindbad. Collection : La bibliothèque de l'Islam, Paris 1999.
- Ibn Arabi : La profession de foi. Actes Sud. Collection Babel, Paris, 2010.
- Ibn Arabi : La profession de foi. Actes Sud. Collection Babel, Paris, 2010.
* Martin Lings :
* Léo Schaya :
* Titus Burckhardt :
- Introduction aux doctrines ésotériques de l'Islam. Dervy, Collection L'être et l'esprit Paris, 2008.
أما مراجع النوع الثاني، فهي الآتية :
* Michel Chodkiewicz :
- Un océan sans rivage. Ibn Arabi : Le livre et la loi. Seuil, Collection : La librairie du XXe siècle, Paris, 2006.
* William Chittick :
- The Sufi Path of knowledge : Ibn al-Arabi's Metaphysics of Imagination. State University of New York Press, 1989.
* Eric Geoffroy :
- Le soufisme en Égypte et en Syrie sous les derniers Mamelouks et les premiers ottomans : Orientations spirituelles et enjeux culturels. Thèse, Institut Français d’Etudes Arabes de Damas (IFEAD) Damas, 1995.
ونذكر من مراجع جيل الرواد :
* Reynold A. Nicholson :
* أبو العلا عفيفي :
- تعريب كتاب ر. أ. نيكلسون : في التصوف الإسلامي وتاريخه، القاهرة، 1956.
* نورالدين شربية :
- تعريب كتاب ر. أ. نيكلسون : الصوفية في الإسلام. القاهرة، 2002.
* Louis Massignon :
- Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane. Paris, 1954.
* Henry Corbin :

- En Islam Iranien, aspects spirituels et philosophiques. Gallimard, Tel, Paris 1991.
- Le paradoxe du Monothéisme, L'Herne, Mythes et religions, Paris 2003.
ومن الدراسات الحديثة، نشير إلى كتابين، وبخاصة إلى الكتاب الجماعي الأول :
* A. Popovic et G. Veinstein (Direction) :
* Rachida Chih :