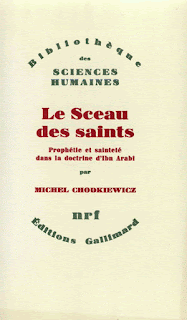مدخل للتصوف
مراجع هامة
Introduction au soufisme
Références majeures
Michel Chodkiewicz :
Le sceau des saints (Prophétie et sainteté dans la doctrine d'Ibn Arabi). Gallimard, Collection : Bibliothèque Sciences Humaines, Paris 1986.
Présentation de l'éditeur :
Le «Maître spirituel» par excellence exerce depuis huit siècles une influence majeure sur la mystique islamique. Une minutieuse analyse des textes permet de préciser une doctrine de l'héritage prophétique et de la médiation des saints entre le Ciel et la Terre, puis de décrire les deux phases du voyage initiatique du saint : montée vers Dieu, descente vers les créatures.
Article d'Éric Geoffroy
Junayd, maître soufi - Article paru dans La Vie du 15 novembre 2007
Surnommé « le seigneur de l’Ordre (des soufis) », Junayd incarne en mystique musulmane le tempérament « sobre » et la quête de la lucidité, face à l’ « ivresse spirituelle » exaltée par Hallâj, son ex-disciple.
D’origine persane, Junayd est l’une des figures proéminentes de l’école de tasawwuf (« soufisme ») de Bagdad ; ce terme allait englober par la suite toutes les modalités spirituelles au sein de l’islam sunnite. A cette époque (IXe-Xe siècles), Bagdad et le califat abbasside étaient le phare du monde. Junayd est d’abord devenu un brillant juriste, avant de s’ouvrir à la mystique sous la direction de son oncle, le soufi Sarî Saqatî (m. 867). Toute sa vie, Junayd a tendu à réaliser l’équilibre entre l’aspect exotérique, normatif, du message islamique, et son aspect ésotérique, initiatique. « Notre science [le soufisme], affirmait-il, est intimement liée au Coran et au modèle muhammadien ». C’est pourquoi il a été agréé par tous les oulémas. Il se montrait d’ailleurs très prudent dans l’enseignement des « secrets de la Voie », qu’il délivrait au fond de sa maison, loin des oreilles profanes. Se réclamer de « la voie de Junayd », de nos jours encore, signifie avoir une démarche spirituelle orthodoxe, mais aussi exigeante.
La méthode de Junayd se fonde en effet sur le jeûne, le silence, la pratique assidue de la retraite et de l’invocation de Dieu, et surtout une observation rigoureuse de la conscience intérieure (« j’ai appris l’art de la vigilance en observant une chatte », disait-il). « Nous n’avons pas reçu le soufisme par des ‘‘on-dit’’, mais par la faim, l’éloignement du bas-monde et la rupture avec les habitudes confortables, affirmait-il ». La méthode austère prônée par Junayd ne supporte aucun artifice, aucune complaisance à l’égard même des plaisirs spirituels qui sont autant de voiles. A une époque où la plupart des adeptes de la Voie pérégrinaient sur les routes, Junayd, quant à lui, disait qu’il avait atteint la réalisation spirituelle « en restant en présence de Dieu, pendant trente ans, sous cet escalier ». Il prônait donc la maîtrise des états spirituels qui traversent l’homme (tamkîn), là où d’autres se plaçaient volontiers sous leur emprise (talwîn). Ainsi, à un soufi qui lui demandait pourquoi il restait statique durant les séances collectives d’invocation de Dieu (dhikr), il répondit par ce verset : « Tu verras les montagnes, que tu croyais immobiles, passer comme des nuages » (Coran 27 : 88). Il revient à l’homme d’invoquer Dieu pour se souvenir du Pacte primordial passé entre Dieu et l’humanité dans le monde spirituel, avant l’incarnation des âmes sur terre. Le verset coranique de référence, que Junayd a beaucoup commenté, est : « Ne suis-Je point votre Seigneur ? Ils dirent : oui, nous en témoignons » (7 : 172).
Tout l’enseignement de Junayd est centré sur la connaissance de l’Unicité (tawhîd), but véritable de la vie spirituelle. Il ne suffit pas d’affirmer que Dieu est unique, comme le fait le commun des croyants ; il faut vivre cette Unicité en soi et en expérimenter les conséquences à tous les niveaux de l’être. « La connaissance de l’Unicité qui est spécifique aux soufis, disait Junayd, consiste à isoler l’éternité de la temporalité, à quitter sa demeure, à rompre les liens avec ce que l’on aime, à laisser de côté ce que l’on sait et ce que l’on ignore ; elle consiste enfin en ce que l’Être divin tient alors lieu de tout ».
Une telle expérience mène à une perplexité d’ordre supérieur : puisque Dieu est l’Être unique, la conscience humaine individuelle ne peut s’unir à Lui qu’en disparaissant, « afin que subsiste ce qui a toujours été, et que s’efface ce qui par nature est illusoire ». C’est le processus du fanâ’, « extinction » de la conscience individuelle dans « l’océan de l’Unicité ». Le sujet qui commence à pressentir la Présence divine doit s’annihiler s’il veut aller plus loin... Faisant allusion à ce paradoxe, un soufi contemporain déclarait : « J’ai entendu de Junayd une parole sur l’Unicité qui m’a plongé durant quarante ans dans une stupeur dont je ne suis pas encore sorti ».
L’expérience du fanâ’ est jouissive car elle libère la conscience humaine des contraintes qu’elle connaît d’ordinaire. « Vivre l’Unicité, disait Junayd, c’est échapper aux limitations temporelles pour s’ouvrir à l’éternité ». Pourtant, Junayd stipule qu’il faut dépasser cette étape, pour « revenir parmi les hommes », lucide, mais désormais investi de la présence pérenne de Dieu : c’est le baqâ’. La recherche de l’extase ne convient qu’aux débutants, la pure contemplation ne saurait être troublée par quelque état d’ivresse ; d’où la condamnation par Junayd des extravagances de Hallâj.
La sainteté de Junayd fut reconnue par tous, même par les juristes les plus sourcilleux, et soixante mille personnes assistèrent à ses funérailles. Sa méthode spirituelle reste un modèle majeur du soufisme, et la plupart des chaînes initiatiques des confréries soufies passent par lui. La doctrine religieuse de certains Etats musulmans, tel le Royaume du Maroc, se réfère officiellement à lui.
La méthode de Junayd se fonde en effet sur le jeûne, le silence, la pratique assidue de la retraite et de l’invocation de Dieu, et surtout une observation rigoureuse de la conscience intérieure (« j’ai appris l’art de la vigilance en observant une chatte », disait-il). « Nous n’avons pas reçu le soufisme par des ‘‘on-dit’’, mais par la faim, l’éloignement du bas-monde et la rupture avec les habitudes confortables, affirmait-il ». La méthode austère prônée par Junayd ne supporte aucun artifice, aucune complaisance à l’égard même des plaisirs spirituels qui sont autant de voiles. A une époque où la plupart des adeptes de la Voie pérégrinaient sur les routes, Junayd, quant à lui, disait qu’il avait atteint la réalisation spirituelle « en restant en présence de Dieu, pendant trente ans, sous cet escalier ». Il prônait donc la maîtrise des états spirituels qui traversent l’homme (tamkîn), là où d’autres se plaçaient volontiers sous leur emprise (talwîn). Ainsi, à un soufi qui lui demandait pourquoi il restait statique durant les séances collectives d’invocation de Dieu (dhikr), il répondit par ce verset : « Tu verras les montagnes, que tu croyais immobiles, passer comme des nuages » (Coran 27 : 88). Il revient à l’homme d’invoquer Dieu pour se souvenir du Pacte primordial passé entre Dieu et l’humanité dans le monde spirituel, avant l’incarnation des âmes sur terre. Le verset coranique de référence, que Junayd a beaucoup commenté, est : « Ne suis-Je point votre Seigneur ? Ils dirent : oui, nous en témoignons » (7 : 172).
Tout l’enseignement de Junayd est centré sur la connaissance de l’Unicité (tawhîd), but véritable de la vie spirituelle. Il ne suffit pas d’affirmer que Dieu est unique, comme le fait le commun des croyants ; il faut vivre cette Unicité en soi et en expérimenter les conséquences à tous les niveaux de l’être. « La connaissance de l’Unicité qui est spécifique aux soufis, disait Junayd, consiste à isoler l’éternité de la temporalité, à quitter sa demeure, à rompre les liens avec ce que l’on aime, à laisser de côté ce que l’on sait et ce que l’on ignore ; elle consiste enfin en ce que l’Être divin tient alors lieu de tout ».
Une telle expérience mène à une perplexité d’ordre supérieur : puisque Dieu est l’Être unique, la conscience humaine individuelle ne peut s’unir à Lui qu’en disparaissant, « afin que subsiste ce qui a toujours été, et que s’efface ce qui par nature est illusoire ». C’est le processus du fanâ’, « extinction » de la conscience individuelle dans « l’océan de l’Unicité ». Le sujet qui commence à pressentir la Présence divine doit s’annihiler s’il veut aller plus loin... Faisant allusion à ce paradoxe, un soufi contemporain déclarait : « J’ai entendu de Junayd une parole sur l’Unicité qui m’a plongé durant quarante ans dans une stupeur dont je ne suis pas encore sorti ».
L’expérience du fanâ’ est jouissive car elle libère la conscience humaine des contraintes qu’elle connaît d’ordinaire. « Vivre l’Unicité, disait Junayd, c’est échapper aux limitations temporelles pour s’ouvrir à l’éternité ». Pourtant, Junayd stipule qu’il faut dépasser cette étape, pour « revenir parmi les hommes », lucide, mais désormais investi de la présence pérenne de Dieu : c’est le baqâ’. La recherche de l’extase ne convient qu’aux débutants, la pure contemplation ne saurait être troublée par quelque état d’ivresse ; d’où la condamnation par Junayd des extravagances de Hallâj.
La sainteté de Junayd fut reconnue par tous, même par les juristes les plus sourcilleux, et soixante mille personnes assistèrent à ses funérailles. Sa méthode spirituelle reste un modèle majeur du soufisme, et la plupart des chaînes initiatiques des confréries soufies passent par lui. La doctrine religieuse de certains Etats musulmans, tel le Royaume du Maroc, se réfère officiellement à lui.
Biographie :
Vers 830 : naissance à Bagdad.
Vers 850 : il devient une autorité en droit musulman, mais approfondit de plus en plus sa perception du soufisme.
897 : Hallâj se sépare de Junayd, qui était son maître spirituel depuis vingt ans.
911 : mort à Bagdad.
Citations :
Vers 830 : naissance à Bagdad.
Vers 850 : il devient une autorité en droit musulman, mais approfondit de plus en plus sa perception du soufisme.
897 : Hallâj se sépare de Junayd, qui était son maître spirituel depuis vingt ans.
911 : mort à Bagdad.
Citations :
Agis en sorte que tu sois une miséricorde pour les autres, même si Dieu a fait de toi une épreuve pour toi-même.
Le soufisme, c’est que le Réel [Dieu] te fasse mourir à toi-même, et qu’Il te fasse vivre par Lui.
Le soufisme, c’est que tu sois avec Dieu, et que tu n’aies plus aucune attache.
La couleur de l’eau provient de la couleur de son récipient.
Cette parole a reçu de multiples interprétations ; elle signifie notamment qu’il y a une seule Religion primordiale (l’eau) qui a pris des colorations multiples (les religions historiques) en fonction des contextes.
Le soufi est comme la terre : on y jette tout ce qui est vil, et il n’en sort que du beau.
Bibliographie :
Junayd, Enseignement spirituel, traduit par Roger Deladrière, Actes Sud, Paris, 1999 (réédition).
E. Geoffroy, Initiation au soufisme, Fayard, 2003, voir index.
Cette parole a reçu de multiples interprétations ; elle signifie notamment qu’il y a une seule Religion primordiale (l’eau) qui a pris des colorations multiples (les religions historiques) en fonction des contextes.
Le soufi est comme la terre : on y jette tout ce qui est vil, et il n’en sort que du beau.
Bibliographie :
Junayd, Enseignement spirituel, traduit par Roger Deladrière, Actes Sud, Paris, 1999 (réédition).
E. Geoffroy, Initiation au soufisme, Fayard, 2003, voir index.
Cet article est consultable sur le site de l'auteur, à l'adresse suivante :
http://www.eric-geoffroy.net/Junayd-maitre-soufi-Article-paru
http://www.eric-geoffroy.net/Junayd-maitre-soufi-Article-paru
Louis Massignon
LA PASSION DE HUSAYN IBN MANSÛR HALLÂJ . Martyr mystique de l'Islam exécuté à Bagdad le 26 mars 922. Étude d'histoire religieuse [1990]. Nouvelle édition. Gallimard.
Présentation de l'éditeur :
TOME I : La Vie de Hallâj, 712 pages + 18 p. hors texte, 14 ill., 140 x 225 mm. Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard -etu. ISBN 2070718913.
Husayn ibn Mansûr Hallâj, martyr mystique de l’amour inconditionnel de Dieu, éprouvé jusqu’à la damnation volontaire, fut exécuté à Bagdad le 26 mars 922. Sa figure, sa présence accompagnèrent Louis Massignon (1883-1962), l’un des plus grands maîtres de l’orientalisme occidental au XXe siècle, depuis sa découverte du saint en 1907, qui conduisit à la rédaction de sa thèse principale de doctorat, jusqu’à la publication du grand œuvre dans cette édition posthume, considérablement augmentée de tous les compléments et rajouts qui furent le fruit d’une incessante quête.
TOME II : La Survie de Hallâj, 528 pages + 16 p. hors texte, 20 ill., 140 x 225 mm. Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard -etu. ISBN 2070718921.
Mars 1907, Massignon prépare au Caire un plan de recherches archéologiques et dans les textes qu’il réunit sur l’histoire du Khalifat à Bagdad «la physionomie d’al Hallâj ressortait, avec une puissance qui - écrivait Massignon - me frappa : le plus beau cas de passion humaine que j’eusse encore rencontré, une vie tendue tout entière vers une certitude supérieure. Le désir me vint de pénétrer, de comprendre et de restituer cet exemple d’un dévouement sans conditions à une passion souveraine.» «Il n’est pas question de prétendre ici que l’étude de cette vie pleine et dure, et montante, et donnée m’ait livré le secret de son cœur. C’est plutôt lui qui a sondé le mien ; et qui le sonde encore.»
TOME III : La Doctrine de Hallâj, 392 pages + 12 p. hors texte, 16 ill., 140 x 225 mm. Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard -etu. ISBN 207071893X.
 L’expérience hallagienne de Louis Massignon, expérience christique et messianique, modèle la conception qu’il se fait de l’islam et plus particulièrement du soufisme. «Tous ces documents remués n’ont pas affaibli mon impression primitive, mais l’ont fortifiée. Il y a vraiment une vertu, une flamme héroïque, dans cette vie ; dans la mort surtout ; qui l’a scellée. J’ai été vivre, près de sa tombe, en son pays. Á l’étudier, peu à peu, ici et là, je crois avoir assimilé quelque chose de très précieux et que je voudrais faire partager à d’autres. Heureux si d’autres que moi ressentent un jour, pour s’être familiarisés avec lui, - ce désir pressant de s’imprégner de la Vérité pleine, non pas abstraite, mais vivante, qui est le sel offert à toute existence mortelle.»
L’expérience hallagienne de Louis Massignon, expérience christique et messianique, modèle la conception qu’il se fait de l’islam et plus particulièrement du soufisme. «Tous ces documents remués n’ont pas affaibli mon impression primitive, mais l’ont fortifiée. Il y a vraiment une vertu, une flamme héroïque, dans cette vie ; dans la mort surtout ; qui l’a scellée. J’ai été vivre, près de sa tombe, en son pays. Á l’étudier, peu à peu, ici et là, je crois avoir assimilé quelque chose de très précieux et que je voudrais faire partager à d’autres. Heureux si d’autres que moi ressentent un jour, pour s’être familiarisés avec lui, - ce désir pressant de s’imprégner de la Vérité pleine, non pas abstraite, mais vivante, qui est le sel offert à toute existence mortelle.» TOME IV : Bibliographie - Index, 336 pages, 140 x 225 mm. Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard -etu. ISBN 2070718948.
le même ouvrage.
le même ouvrage.
«Ainsi commencé, par goût profane, pendant deux ans, cet ouvrage continué depuis par obéissance chrétienne, s’achève au bout de quatorze années. Et maintenant, me voici de nouveau à l’orée d’un désert : entendant le vent se lever, sur le seuil de la tente, entre les pierres du foyer, à la brise avant-courrière de midi ; heure bénie, où trois passants qui s’en allaient incendier une cité perdue, s’arrêtèrent, - et offrirent à Abraham, leur hôte d’un instant, l’amitié divine.»